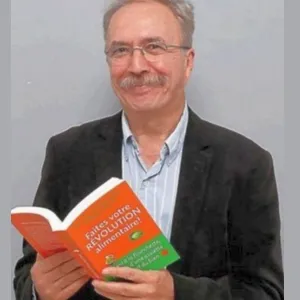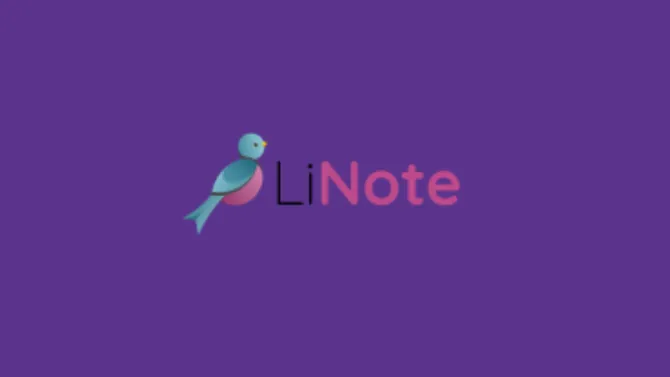Être informé c'est aussi une forme de protection

Gaëlle Bourgeois nommée Directrice générale de La Mutuelle Familiale
21/11/2025
lire l'article
Lire l'article
👋 Bienvenue sur l'assistance de La Mutuelle Familiale, besoin d'aide ?
Nous sommes là pour vous aider