Publié le · 3 Min. de lecture

Le Blog de la Mutuelle Familiale
La Mutuelle Familiale
Sécurité sociale : financement et solidarité
- Votre mutuelle
- Militantisme
La saga des 80 ans de la Sécu - n°3

 « De chacun selon ses ressources, à chacun selon ses besoins »
« De chacun selon ses ressources, à chacun selon ses besoins »
Attribuée à Ambroise Croizat, la formule « De chacun selon ses ressources, à chacun selon ses besoins » exprime ce que voulaient les créateurs de la Sécurité sociale : que chacun finance la protection sociale selon ce qu’il gagne et que chacun reçoive les prestations dont il a besoin.
Du côté des ressources, cela signifie que la Sécurité sociale se finance par les cotisations sociales. On prélève un pourcentage sur le salaire de chacun, de sorte que plus on gagne, plus on cotise : « de chacun selon ses ressources ».
Du côté des prestations sociales, le meilleur exemple, ce sont les remboursements de l’assurance maladie, qui ne tiennent pas compte des revenus mais uniquement de l’état de santé. Par exemple, en cas de maladie de longue durée reconnue, les remboursements sont plus élevés : c’est « à chacun selon ses besoins ».
Ce principe définit le cadre général de la Sécurité sociale. Cependant, pour atteindre d’autres objectifs, certaines règles dérogent à ce principe : les cotisations retraite sont plafonnées au-delà d’un certain salaire et certaines aides, comme les allocations logement, sont soumises à condition de ressources.
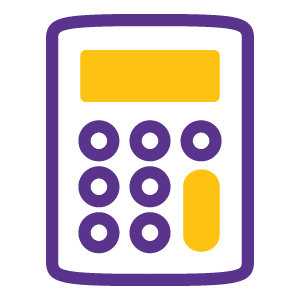
Le recul de la part des cotisations sociales dans le financement de la Sécurité sociale
En 40 ans, entre 1982 et 2022, la part des cotisations sociales dans le financement de la Sécurité sociale est passée de 81 % à 55 %*. Cette évolution structurelle s’explique d’abord par la politique d’exonération de cotisations sociales, débutée en 1993 et qui, dès lors, n’a cessé d’être amplifiée. Les montants exonérés sont partiellement compensés par des fractions d’impôt sur le revenu et de taxes (tabac et alcool, notamment), ce qui implique une fiscalisation du financement de la Sécurité sociale.
Ce phénomène a parallèlement été accentué par la création de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1990. Ce prélèvement, considéré comme impôt, a une assiette large qui inclut, outre les revenus d’activité, la retraite et le chômage ainsi que les revenus du patrimoine.
Ces évolutions n’affectent pas de façon importante le niveau des ressources globales de la Sécurité sociale. Elles l’éloignent cependant de son modèle initial qui reliait, au travers de la cotisation sociale, le salarié à cette institution. Cela se reflétait par ailleurs dans la gouvernance de la Sécurité sociale puisque, à l’origine, les représentants élus des salariés disposaient des trois quarts des sièges du conseil d’administration. Fiscalisation rime ainsi avec Etatisation.
* Source : Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale édition 2023

Plusieurs logiques à l’œuvre
La sécurité sociale recouvre un ensemble de prestations sociales qui relèvent de logiques différentes.
Certaines prestations sont en principe universelles, en ce sens qu’elles s’adressent à tous, indépendamment de la situation de la personne, notamment de ses revenus. Ainsi, en matière santé, depuis 2016, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie.
D’autres prestations relèvent d’un mécanisme de solidarité nationale venant en aide aux personnes dont les revenus sont les plus modestes : revenu de solidarité active (RSA), allocation logement, certains prestations familiales (prime à la naissance, allocation de base de la prestation d’accueil du jeunes enfant, allocation de rentrée scolaire…). L’allocation personnel d’autonomie (APA), comme d’autres prestations, se réduit lorsque les revenus augmentent.
Ces deux catégories de prestations corrigent en partie les inégalités initiales de revenus qui découlent l’organisation du système productif et des différences de patrimoine. C’est le cas naturellement des prestations de solidarité nationale mais c’est aussi celui des prestations universelles. En effet, les personnes disposant des plus faibles revenus sont aussi celles qui ont le plus de besoins. Lorsque les prestations sont effectivement accessibles à tous, elles contribuent donc à compenser les inégalités. Par exemple, parce que davantage malades, les personnes ayant des ressources financières faibles sont davantage soignées et donc reçoivent davantage de remboursement de frais de santé de la part de l’assurance maladie.
Enfin, les retraites et les allocations, même si des minimas sociaux existent, reposent sur un principe de contributivité : la prestation versée dépend de la durée d’affiliation et des montants cotisés.

Pour un renforcement de la primauté des cotisations sociales
Pour La Mutuelle Familiale, l’objectif d’assurer une couverture plus solidaire des besoins sociaux doit passer par l’accroissement de la redistribution sociale assurée par la Sécurité sociale. Cela implique que ses ressources soient suffisantes et aussi d’en renforcer la lisibilité pour améliorer son acceptabilité par les citoyens. La solidarité doit s’exercer dans la façon dont chacun contribue selon ses moyens à l’effort collectif et aussi dans la prise en charge des risques.
La Mutuelle Familiale considère qu’il faut revenir à la primauté de la cotisation sociale pour financer de la Sécurité sociale. Cela nécessite notamment de supprimer les exonérations et les exemptions d’assiette de cotisations sociales. Une réflexion doit aussi être poursuivies pour augmenter les taux de cotisations des entreprises mal situées en termes de critères sociaux et environnementaux. Il faudrait également prélever des cotisations sur les dividendes versés par les entreprises à leurs actionnaires.
La Mutuelle Familiale est également opposée au projet de TVA dite sociale, qui consiste à remplacer des cotisations sociales par une augmentation du ou des taux de TVA. Outre qu’une telle évolution accroitrait encore la fiscalisation des ressources de la Sécurité sociale, elle désavantagerait les ménages disposant des revenus les plus faibles, qui consacrent une proportion plus grande de leur revenu à la consommation, pour des effets contestables en matière de compétitivité.
Par ailleurs, depuis le début des années 2000, la taxe sur les complémentaires santé n’a fait d’augmenter et atteint désormais 14,07 % pour un contrat responsable. Soit plus d’un mois et demi de cotisations pour les adhérents ! Le hamburger, dont on connait les effets délétères de la consommation sur la santé, est quant à lui imposé au taux de 5,5 %. Cette taxe injuste, proportionnelle à la cotisation hors taxe, qui pénalise les personnes âgées et celles, plus largement, qui ne bénéficient pas d’une couverture collective, doit être supprimée.




