Publié le · 3 Min. de lecture

Le Blog de la Mutuelle Familiale
La Mutuelle Familiale
Sécurité sociale : les grands principes
- Votre mutuelle
- Militantisme
La saga des 80 ans de la Sécu - n°1

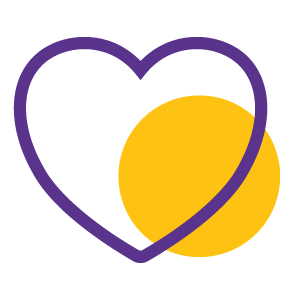
Un système d’entraide collective face aux risques de l’existence
- La Sécurité sociale est un grand système d’entraide pour faire face aux risques de la vie. Maladie, maternité, handicap, invalidité, précarité, retraite... beaucoup de choses peuvent arriver. Avec des aides adaptées aux besoins de chacun, la Sécurité sociale permet à tout le monde de s’en sortir. Sans cette solidarité, chacun devrait se débrouiller seul ou avec l’aide de ses proches. Ce serait injuste, car ceux qui ont des revenus et des patrimoines élevés pourraient toujours trouver des solutions, contrairement à ceux qui ont moins de moyens.
- La Sécurité sociale fonctionne comme un pot commun. Chacun y contribue selon ses revenus et reçoit de l’aide selon ses besoins. Par exemple, en cas de maladie, la Sécurité sociale rembourse une partie des frais de soins sans tenir compte des revenus. Obligatoire pour toute personne vivant en France, elle met en place un système de solidarité exemplaire entre actifs et inactifs, bien-portants et malades, riches et moins riches.
- La Sécurité sociale, c’est aussi le projet d’une société juste et solidaire, qui aide chacun à s’émanciper. Car être protégé face aux évènements de la vie est une condition de la liberté individuelle. Dans ce modèle de société, l’État joue un rôle actif en organisant un compromis entre libertés individuelles et exigences collectives. C’est une certaine idée du vivre-ensemble qui s’exprime, où la Sécurité sociale est un élément clé d’un fonctionnement démocratique qui ne se limite pas au vote.

Ambroise Croizat - Les fondateurs
Composante essentielle du modèle social Français, la Sécurité sociale est née de la volonté de femmes et d’hommes engagés dans la résistance à l’oppresseur nazi. Ils voulaient mettre en place un grand système d’entraide une fois la guerre finie. En 1945, tout le pays devait être reconstruit. Il n’y avait pas de retraite et la mortalité infantile était très élevée. Comment débarrasser les citoyens de l’incertitude du lendemain ? C’était l’objectif du projet du Conseil National de la Résistance.
En s’appuyant sur le travail d’Alexandre Parodi et les compétences techniques de Pierre Laroque, Ambroise Croizat lance la création de la Sécurité sociale. Député de Paris en 1936, il avait participé aux accords Matignon. Emprisonné en 1939 suite au pacte de non-agression germano-soviétique, il est libéré en février 1943. Nommé par la CGT clandestine à l’Assemblée consultative, Ambroise Croizat rejoint le général de Gaulle. Il déclare dans son discours inaugural à Radio Alger : « Notre peuple n’aura pas souffert pour rien, nous lui donnerons la dignité et la sécurité sociale ! ». Nommé ministre du Travail, il s’attelle au programme du Conseil national de la résistance dès novembre 1945 et laissera au peuple d’immenses avancées, notamment sur la Sécurité sociale,
la médecine du travail, le Code du travail. En 1951, un million de personnes l’accompagnent au Père-Lachaise.
Aujourd’hui, fort de ces acquis, de nouveaux défis nécessitent un nouveau programme pour la Sécurité sociale. La dégradation de l’environnement et le vieillissement de la population, notamment, ont des conséquences importantes sur notre système de protection sociale.
Comment construire la Sécurité sociale de demain ? C’est un défi collectif, immense et essentiel.
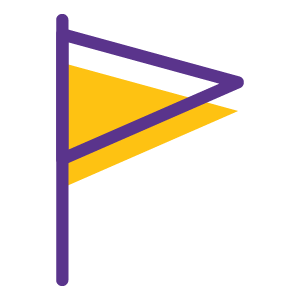
Généralisation, unité et démocratie - Trois grands principes
Trois grands principes sont inscrits dans l’ordonnance n° 45-2259 du 4 octobre 1945, qui est le véritable acte de naissance de la Sécurité sociale :
- La généralisation progressive de la Sécurité sociale à toute la population. Au début, la Sécurité sociale couvre les travailleurs et leurs familles, mais l’idée de l’étendre à tout le monde est présente dès le départ.
- L’unité des institutions et l’universalité des risques. Même s’il existe des régimes spéciaux à côté du régime général des salariés, l’objectif est de créer un cadre unique pour tout le monde.
- La démocratie sociale. La Sécurité sociale est composée d’organismes privés autonome dans leur gestion. Ces structures sont dirigées par des conseils d’administration où siègent des représentants des salariés et des employeurs.
En outre, l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 fixe le rôle de la mutualité :
Les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l’intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d’entraide visant notamment :
1°) La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;
2°) L’encouragement de la maternité et la protection de l’enfance et de la famille ;
3°) Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.
Ce cadre très large a permis aux mutuelles de s’adapter au fil des 80 dernières années aux évolutions des lois et des besoins sociaux.

La Mutuelle Familiale, une mutuelle engagée pour une Sécurité sociale de haut niveau
La Mutuelle Familiale est profondément attachée à une Sécurité sociale de haut niveau qui couvre largement les besoins sociaux. Cela fait partie de son ADN.
Un exemple de cet engagement est l’épisode de 1958, où le pouvoir gaulliste a reculé sur la mise en place d’une franchise :
« Pendant toute la période du pouvoir gaulliste, La Mutuelle Familiale continue de jouer un rôle actif dans la défense de la Sécurité sociale et la structuration nationale des mutuelles de travailleurs. L’arrivée du général De Gaulle au pouvoir en 1958 est saluée par certains dirigeants
de la FNMF […]. De son côté, La Mutuelle Familiale, comme le PCF et la CGT, appelle à voter « non » au référendum du 28 septembre 1958 qui pose les fondements de la Ve république.
Le 30 décembre 1958, l’ordonnance prise par le nouveau pouvoir et portant loi de finances pour 1959, institue dans son article 4 la franchise qui prive les assurés sociaux de tout remboursement de la Sécurité sociale pour la partie de leurs dépenses semestrielles […]. »
Cette franchise est tout à la fois injuste dans son principe et excessivement lourde pour les assurés sociaux. La FNMF la dénonce mais elle conseille néanmoins aux sociétés mutualistes de pallier les carences de la Sécurité sociale. La réaction de La Mutuelle Familiale est différente.
[…] elle indique : « Nous ne sommes en rien responsables d’une telle monstruosité […]. Prendre la charge de la franchise à la mutuelle signifierait [une] augmentation des cotisations. Là encore nous serions à l’origine d’une aggravation des conditions des travailleurs […]. »
Un vaste mouvement rassemble les organisations syndicales, sociales, familiales et les mutuelles de travailleurs. La Mutuelle Familiale pétitionne et elle est présente le 30 mai 1959, salle Blanqui à Paris, à l’appel du Cartel national de défense des prestations familiales et sociales, constitué pour l’occasion. Ce mouvement social contraint le pouvoir à reculer et à annuler la franchise en juin 1959. »
Extrait de « Militants de la solidarité – Une histoire de La Mutuelle Familiale » de Marc Zamichiei.





