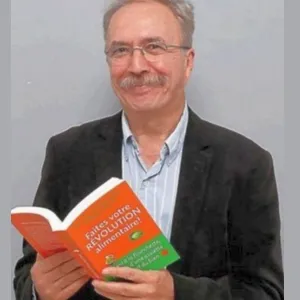Publié le · 5 Min. de lecture

Le Blog de la Mutuelle Familiale
La Mutuelle Familiale
Rendre visible l’origine professionnelle des cancers
- Santé environnement
- Santé travail
- Santé des femmes
Le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers d’Origine Professionnelle et Environnementale dans le Vaucluse (GISCOPE 84) œuvre pour rendre visible l’origine professionnelle et environnementale de cancers du sang, afin d’en améliorer la reconnaissance et la prévention. Entretien avec son codirecteur, Moritz Hunsmann, chercheur en sociologie et santé publique au CNRS.

Pouvez-vous expliquer ce qu’est le Giscope ?
Moritz Hunsmann : Le GISCOPE 84 regroupe une douzaine d’organismes variés (1), qui s’unissent pour faire exister un programme de recherche-action. Ce programme est porté par une équipe pluriprofessionnelle des secteurs de la santé et de la santé au travail, ainsi que de scientifiques d’institutions et de disciplines différentes, qui enquêtent sur les cancers d’origine professionnelle et environnementale – deux dimensions étroitement liées (2). C’est un projet de recherche-action, c’est-à-dire que nous essayons de comprendre la réalité pour la transformer. L’objectif est de rendre visibles les expositions professionnelles aux cancérogènes et les cancers qui en résultent, pour en améliorer la prévention et la reconnaissance en maladies professionnelles. Cette question de la reconnaissance est importante : au niveau individuel, elle offre aux patients une prise en charge intégrale des soins liées à la maladie et une rente. Au niveau collectif, elle évite que les coûts liés à la maladie professionnelle soient indûment supportés par la branche maladie de la Sécurité sociale, alors qu’ils devraient l’être par la branche accidents du travail – maladie professionnelle (AT-MP), qui est exclusivement abondée par les employeurs.
Concrètement, comment procédez-vous ?
M.H. : Nous proposons systématiquement un accompagnement aux patients pris en charge dans les établissements du Groupement Hospitalier de Territoire du Vaucluse (GHT 84) pour des lymphomes non-hodgkiniens (LNH) et des myélomes multiples, qui sont des cancers hématologiques. Nous reconstituons avec eux leur parcours professionnel et leur demandons de décrire précisément leurs activités de travail à chaque poste occupé. Un collectif d’expertise composé de personnes qui ont des connaissances précises des différents secteurs professionnels (médecins et infirmières du travail, ingénieurs de prévention, chimistes, sociologues, toxicologues…) identifient, à chaque poste occupé, les expositions possibles, probables ou avérées à des cancérogènes, parmi une liste de 65 cancérogènes classés par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et/ou l'Union Européenne. Pour cela, ils s’appuient sur des connaissances très précises des activités de travail et des produits utilisés dans les différents secteurs en fonction des époques, car une même activité n’exposait pas aux mêmes cancérogènes en 1975 et en 2005. Le collectif donne ensuite un avis sur la possibilité pour les malades d’engager une déclaration de maladie professionnelle. Puis une assistante sociale leur présente les résultats et leur explique en quoi consiste la procédure de demande de reconnaissance. C’est aux malades de décider s’ils s’engagent dans la démarche ou non. Nous proposons ensuite de les accompagner tout au long du processus.
À ce jour, quels sont vos constats ?
M.H. : Depuis qu’elle a débuté en 2017, plus de 500 patients ont été pris en charge dans le cadre de l’enquête. 56 % d’entre eux ont été orientés vers une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle, car, dans leur travail, ils ont été exposés de manière importante à des cancérogènes connus pour être en lien avec leur pathologie. C’est un taux énorme ! Seule la moitié d’entre eux ont engagé la procédure. À ce jour, 10 % des patients qui sont passés chez nous ont obtenu une reconnaissance en maladie professionnelle, alors que plus de la moitié des dossiers sont encore en cours d’instruction. C’est déjà 20 fois plus que le taux moyen national de reconnaissance en maladie professionnelle des cancers du sang – qui, comme pour l’ensemble des cancers, est en-dessous de 0,5 % des nouveaux cas. Il y a une sous reconnaissance abyssale en France, notamment parce qu’il n’y a aucun dispositif systématique au niveau national pour identifier les expositions professionnelles subies par les personnes atteintes de cancers.
Concernant les secteurs d’activité, le monde agricole est très touché, avec de nombreuses expositions aux pesticides, mais d’autres secteurs ou types d’activités sont également concernés : l’industrie chimique et nucléaire, le travail du métal, les carrossiers et les garagistes, les peintres, les activités de nettoyage… Enfin, il y a de fortes inégalités de genre devant les expositions et devant la reconnaissance en maladie professionnelle.
Pouvez-vous nous expliquer ces inégalités ?
M.H. : Nous nous sommes aperçus qu’au début de notre enquête, nous avions orienté bien moins de femmes que d’hommes vers une déclaration de maladie professionnelle. Ensuite, proportionnellement, elles étaient moins nombreuses à s’engager dans la démarche et, lorsqu’elles le faisaient, elles avaient moins de chances que les hommes de voir leur cancer reconnu en maladie professionnelle. À chaque étape du processus, les femmes devenaient plus invisibles ! Il y a de nombreuses raisons à cela. D’une part, les femmes cumulent moins d’années de travail salarié que les hommes, elles ont souvent des parcours plus fragmentés, et les tableaux de maladie professionnelle concernent principalement les activités à prédominance masculine, ce qui, pris ensemble, complique largement la reconnaissance en maladie professionnelle des cancers des femmes. Aussi, nous avons constaté une méconnaissance des expositions professionnelles dans les activités principalement exercées par des femmes. Par exemple, les métiers du nettoyage ne sont généralement pas considérés comme exposant à des substances cancérogènes. Depuis que nous avons fait ce constat, nous avons créé un groupe de travail dédié aux activités de nettoyage, d’hygiène et de désinfection. Nous avons réalisé des analyses de produits ménagers courants et avons identifié la présence de sept cancérogènes. Résultat : nous analysons mieux les expositions des femmes et en orientons davantage vers la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle.
Qu’envisagez-vous pour la suite ?
M.H. : Un chantier important est la formation. Nous avons développé le diplôme universitaire « Cancer – Travail – Environnement » , pour former les professionnels de santé, les assistantes sociales, les représentants syndicaux ou encore les acteurs associatifs (associations de malades par exemple) aux enjeux liés aux cancers d’origine professionnelle et environnementale. Par ailleurs, nous projetons de développer un dispositif transférable d’accès aux droits pour briser l’invisibilité des cancers professionnels. Ce dispositif donnerait aux services oncologiques les moyens de poser systématiquement la question des expositions professionnelles subies par les personnes chez qui un cancer est diagnostiqué et d’accompagner les malades éligibles vers l’accès au droit. Le financement de ce type de recherche-action est un combat de tous les jours. Pour nous permettre de poursuivre nos actions, nous avons lancé un appel à dons, via le Fonds de dotation « Agir contre les cancers du Travail ».
La Mutuelle Familiale vous soutient financièrement. Que vous apporte cette aide ?
M.H. : Notre Groupement fonctionne en grande partie grâce à des financements obtenus dans le cadre d’appels à projets compétitifs, dont l’issue est par nature incertaine. L’aide non conditionnelle de La Mutuelle Familiale contribue à un financement-socle, qui nous permet de stabiliser l’équipe et de développer des projets, qui seront en partie financés via appels à projets. Comme j’ai pu le dire lors du colloque au Sénat en février 2024, ou dans le cadre de l’association Mutuelles pour la santé planétaire (3), il est important et encourageant que les mutuelles se saisissent de leur rôle d’acteurs de santé publique, comme le fait La Mutuelle Familiale.
- Sont membres du GIS, le Centre hospitalier d’Avignon, Avignon Université, le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités en Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREETS PACA), la Ligue contre le Cancer (Comité départemental du Vaucluse), l’Association Interentreprises pour la Santé au Travail du Vaucluse (AIST 84), l’Association Phyto-Victimes, la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD), l’Association Cancer Aide Information aux Entrepreneurs du Vaucluse (CAIRE 84), le Comité Départemental d’Éducation pour la Santé de Vaucluse (CoDES 84), l’Association Ensemble Leucémies Lymphomes Espoir (ELLyE) et, depuis 2025, La Mutuelle Familiale. Le Conseil régional de la Région Sud/PACA et l’ARS PACA sont membres invités.
- Moritz Hunsmann, Benjamin Lysaniuk. Faire entrer en résonance santé-travail et santé-environnement. Écologie & politique : sciences, culture, société, 2019, 58 (1), pp. 83-106. ⟨10.3917/ecopo1.058.0083⟩. ⟨halshs-02142293⟩
- (3) Groupe de mutuelles réunies pour faire face à la toxicité de l’amiante et des pesticides.
En savoir plus : https://giscope84.hypotheses.org/du